 Depuis le 11 décembre 2002, et la fermeture du camp de Sangatte par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, les « opérations massives de police » se suivent et se ressemblent sur le littoral de Calais.
Depuis le 11 décembre 2002, et la fermeture du camp de Sangatte par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, les « opérations massives de police » se suivent et se ressemblent sur le littoral de Calais.
Les rafles des 25 et 26 septembre 2012 n’ont pas dérogé à la règle, qui est toute simple. Le matin, la police arrête autant de personnes que peuvent en remplir les estafettes ; le soir, elle envoie autant d’étrangers que peuvent en contenir les centres de rétention, en vue de les éloigner [définitivement du territoire] temporairement du Calaisis. Officiellement, c’est une procédure pénale, c’est-à-dire une enquête pénale menée sous le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire. Officieusement, c’est pour nettoyer les lieux – au Karcher, si possible.
La mairie de Calais, gestionnaire des locaux affecté à la distribution de repas pour les migrants, et qui tolérait leur présence le midi entre 13h et 15h et le soir entre 18h et 20h, se plaignait que plusieurs dizaines d’entre eux y trouvent refuge plus longtemps. De fait, à la nuit tombée, sous les abris métalliques de la rue de Moscou, adossés aux palissades, se terraient une soixantaine de Tunisiens, Afghans, Palestiniens, Iraniens, Irakiens, Erythréens, Ethiopiens, Koweitiens et Syriens. Mais, comme disait le précédent ministre de l’Intérieur : un Arabe, ça va, c’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes.
Fin août 2012, le maire de Calais sollicitait du tribunal administratif de Lille une ordonnance aux fins d’expulser les squatteurs de la rue de Moscou. Rejet – prévisible – de la requête. La municipalité aurait été mieux inspirée de requérir le préfet, et de justifier qu’étaient bien remplies les conditions strictes prévues à l’article 38 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Ensuite de quoi, le préfet aurait dû notifier aux occupants une mise en demeure de quitter les lieux, dans un délai « qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». En l’absence d’exécution volontaire de leur part, l’autorité administrative aurait alors dû procéder à leur évacuation forcée.
Cela, c’est ce qui se serait passé dans un monde parfait (un monde de Droit). Mais, comme le répète régulièrement à l’audience un haut magistrat (lecteur vigilant de ce blog) : « Si on appliquait les textes, les policiers n’arrêteraient plus personne ! »
Alors, dans un monde « normal » (un monde de droite), le préfet a préféré, plutôt que d’envoyer un huissier avertir les clandestins qu’ils avaient vingt-quatre heures pour déguerpir, sacrifier à la coutume locale : la rafle de quelques dizaines de migrants à 7 heures du matin.
Les 25 et 26 septembre 2012 à Calais, 75 clandestins et 24 mineurs était interpellés. Par parenthèses, c’est deux fois moins que le score d’Eric Besson, lorsqu’il avait « démantelé » la Jungle de Calais le 22 septembre 2009 : 141 clandestins et 135 mineurs (source : le Guiness Book des Records Idiots que Tout Ministre de l’Intérieur Rêve de Dépasser).
Le matin du 25 septembre 2012, des bruits de bottes ont donc réveillé soixante-quatorze personnes blotties à même le sol, dans leurs couvertures de survie ou leurs sacs de couchage, réfugiés sous les abris de la rue de Moscou.
« Constatons la présence de soixante quatorze personnes situées sous les préaux, ces derniers dorment dans des sacs de couchage, sur des matelas à même le sol », narrent les policiers dans leur procès-verbal d’interpellation. Pas moins de neuf officiers de police judiciaire notifient aux étrangers, avec l’aide d’interprètes, leur placement en garde à vue, au motif qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis ou tenté de commettre un délit puni d’une peine d’emprisonnement, en l’espèce l’infraction d’« installation en réunion sur le terrain d’autrui, sans autorisation, en vue d’y habiter ».
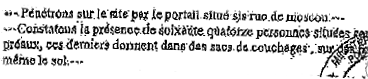
Précisément, l’article 322-4-1 du Code Pénal invoqué par les policiers réprime : « le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain ».
Ce rappel étant fait, quelqu’un peut-il maintenant expliquer en quoi « un préau » pourrait être assimilé à « un terrain » ?
 Les préaux de la rue de Moscou constituent une salle couverte et close d’un seul côté, à l’égal d’un garage, de halles, d’un pavillon. Certes, ils sont situés » sur un terrain » propriété de la mairie, mais ni plus ni moins que toute autre construction édifiée » sur un terrain « . Autrement dit, notamment en raison de leur étendue (sur plusieurs dizaines de mètres carrés), leur structure, et leur utilité, il s’agit de bâtiments. C’est-à-dire, selon la définition qu’en donne le Dicobat : « tout ouvrage durable, construit au-dessus du niveau du sol, et ayant une fonction d’abri ».
Les préaux de la rue de Moscou constituent une salle couverte et close d’un seul côté, à l’égal d’un garage, de halles, d’un pavillon. Certes, ils sont situés » sur un terrain » propriété de la mairie, mais ni plus ni moins que toute autre construction édifiée » sur un terrain « . Autrement dit, notamment en raison de leur étendue (sur plusieurs dizaines de mètres carrés), leur structure, et leur utilité, il s’agit de bâtiments. C’est-à-dire, selon la définition qu’en donne le Dicobat : « tout ouvrage durable, construit au-dessus du niveau du sol, et ayant une fonction d’abri ».
Or, la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dite « loi Sarkosy », laquelle a introduit dans le Code pénal l’article 322-4-1, a été conçue par le gouvernement et votée par le législateur afin de lutter contre les implantations sauvages de gens du voyage et de Roms. Elle visait à sanctionner pénalement les installations de caravanes, de tentes ou d’abris de fortune, sur des terrains communaux ou privés. En aucun cas, à poursuivre les occupants d’un bâtiment, même recroquevillés dans des sacs de survie.
Tout d’abord, parce les débats parlementaires sont dénués de toute ambiguïté sur l’étendue de l’article 322-4-1.
Ensuite parce que les textes pénaux sont d’interprétation stricte : un « terrain » n’est pas un « bâtiment ».
Enfin, parce qu’il existe un autre texte, spécialement applicable à l’occupation de tout type de logements et de locaux ainsi que leurs dépendances : l’article 226-4 du même Code, relatif à la « violation de domicile ». Mais ce dispositif était en l’espèce plus difficile à mettre en œuvre, puisqu’il fallait établir l’existence de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » commis par les occupants (comme pour l’article 38 de la loi du 5 mars 2007). Ce qui, s’agissant des préaux de la rue de Moscou, est tout sauf évident, notamment parce que leur propriétaire y accepte la présence des migrants au moins quatre heures par jour.
En l’état des constations faites par la police à l’aube du 25 septembre 2012, il est donc des plus douteux que l’article 322-4-1, ou même l’article 226-4 du Code pénal, aient pu utilement être invoqués pour justifier le placement en garde à vue de soixante-quatorze personnes.
Alors à quoi bon emmener tout le monde au commissariat ? La réponse allait être fournie quelques heures plus tard par le préfet du Pas-de-Calais.
![VU la procédure pour séjour irrégulier... [qui n'existe pas]](https://www.pole-juridique.fr/img/arrete_25-09-2012.png)
Dans les arrêtés de placement en rétention administrative pris le soir même, l’autorité administrative se réfère à « la procédure pour séjour irrégulier ET installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y habiter ». En réalité, les procès-verbaux d’interpellation, d’avis au procureur, de placement en garde à vue, d’audition, de fin de garde à vue, et de rappel à la loi ne se réfèrent qu’à une seule et unique infraction poursuivie. L’enquête portait officiellement sur une prétendue occupation de terrain en réunion et sans autorisation. Mais le préfet, qui n’est pas né la dernière pluie, savait pertinemment que l’enquête avait pour principal – si pas unique – objet le séjour irrégulier (infraction qui n’autorise pas à elle seule un placement en garde à vue) ; et que la garde à vue avait pour principal – si pas unique – intérêt de préparer les arrêtés de placement en rétention administrative qui allaient suivre.
La même semaine, Manuel Valls, nouveau ministre de l’Intérieur, annonçait un projet de loi visant à créer une rétention administrative de 16 heures, destinée à remplacer les gardes à vue d’étrangers en situation irrégulière… Drôle d’idée ! A quoi bon chercher à créer de nouvelles procédures, lorsque les anciennes peuvent si facilement être détournées ? D’ailleurs à ce jour, tant les juridictions civiles qu’administratives n’ont rien trouvé à reprocher aux actions menées par le préfet du Pas-de-Calais le 25 septembre 2012…
Pour la petite histoire, on se souviendra que le projet de « loi Sarkozy » sur la sécurité intérieure, qui a servi de prétexte au placement en garde à vue de soixante-quatorze personnes ce 25 septembre 2012, avait en son temps été dénoncé par le Parti socialiste, dans son appel du 21 octobre 2002. A l’époque, « la gauche » écrivait que cette loi touchait « à la nature même de la République » et conduirait « à un Etat autoritaire », qui avait décidé « d’entrer en guerre contre les pauvres » : « le gouvernement détient tous les pouvoirs, mais il a n’a pas reçu mandat de faire de l’inégalité et de l’arbitraire des règles de la République. » C’est beau comme un discours d’Eric Besson.
C’est ça le changement : en 2002, on critique les lois ; en 2012, on les applique – mal, mais on les applique.
