Qu’est-ce qui oblige les policiers à nourrir et à donner à boire aux sans-papiers, pendant l’enquête qui précède leur placement en rétention ? Et qu’est-ce qui force les juges judiciaires à s’en assurer ? Six mois après la loi du 31 décembre 2012 qui a créé la retenue administrative de seize heures pour vérification du droit au séjour, deux magistrats perspicaces viennent de faire cette découverte étonnante : « la mention relative à la prise d’eau et de nourriture n’est pas imposée par le CESEDA »…
Effectivement, si en matière pénale, l’article 64 CPP exige que cette information figure sur un procès-verbal émargé par le gardé à vue, en revanche, en matière de séjour des étrangers, le tout nouvel article L.611-1-1 CESEDA ne prévoit strictement rien. Il est vrai que lorsqu’il légifère en matière de droit des étrangers, le parlement associe une réflexion de moineau à une précipitation de brute, et la loi du 31 décembre 2012 en est une parfaite illustration. Alors, dans le silence des textes, faut-il dorénavant considérer que les étrangers retenus au commissariat devront toujours faire disette ? Farpaitement !
 Contrôlé le 18 juillet 2013 à 10h15, Monsieur D., ressortissant nigérian, ne ressort du commissariat que six heures plus tard, pour être conduit au centre de rétention. Il se plaint que dans l’intervalle, les policiers ne lui aient proposé ni eau ni nourriture, et qu’il ait dû patienter jusqu’au diner, servi à partir de 18h au centre de rétention.
Contrôlé le 18 juillet 2013 à 10h15, Monsieur D., ressortissant nigérian, ne ressort du commissariat que six heures plus tard, pour être conduit au centre de rétention. Il se plaint que dans l’intervalle, les policiers ne lui aient proposé ni eau ni nourriture, et qu’il ait dû patienter jusqu’au diner, servi à partir de 18h au centre de rétention.
Lors de l’audience du 24 juillet 2013 devant le juge des libertés et de la détention, il fait donc valoir qu’il a subi des mauvais traitements. Le magistrat écarte ses protestations, objectant que s’il n’est pas mentionné dans la procédure qu’il a pris de la boisson et de la nourriture, il n’est pas non plus précisé qu’il en a été privé. Rien de bien nouveau, d’intéressant, ni de très original, dans une telle motivation. C’est le fameux défi dit « du chameau », par lequel un juge judiciaire demande à un étranger d’établir la preuve impossible d’un fait négatif.
La motivation de la Cour sera quant à elle plus complète, et plus audacieuse.
Le juge d’appel reprend d’abord, pour l’approuver, l’argumentaire de son prédécesseur. Il ajoute que l’étranger aurait dû établir, non seulement qu’il n’avait rien bu ni mangé pendant toute la retenue ; mais encore qu’il avait réclamé de le faire ; et qu’enfin les policiers avaient refusé. En somme, le sans-papier aurait dû disposer d’un genre de procès-verbal de police ainsi rédigé : « Monsieur D. a réclamé à plusieurs reprises à boire et à manger, ce que nous avons refusé à chaque fois, motifs pris que : 1) Ce n’est pas le boulot des enquêteurs ; d’ailleurs, ils avaient leur pause déjeuner 2) Un commissariat, c’est une auberge espagnole : on y mange ce qu’on y apporte 3) C’est Ramadam, et Monsieur D. n’avait pas de document qui prouve qu’il n’était pas un musulman pratiquant ». Etant rappelé que rien n’oblige, légalement, les policiers à mentionner de telles informations, un procès-verbal qui attesterait que l’étranger « s’est vu opposer un refus à une demande de boissons ou d’aliments » n’a de chances d’exister que dans le cerveau d’un magistrat en train de faire la sieste.
Le juge d’appel va maintenant s’intéresser à la question de fond : même à la supposer établie, cette privation de boissons et d’aliments serait-elle constitutive d’un mauvais traitement ?
Relevant que la retenue de l’étranger « n’a duré que pendant la durée [sic] strictement nécessaire à la vérification de la régularité du séjour », une période « relativement restreinte », le premier président estime que la mesure « ne s’est pas prolongée au point qu’elle obligeait les services à lui proposer de leur propre chef de s’alimenter ou boire ». Et de conclure à l’absence de « comportement de nature à constituer une contrainte disproportionnée de l’étranger de la part des services de police ».
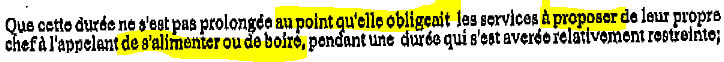
Donner à boire et à manger à un prisonnier étranger ne serait pas un impérieuse nécessité, mais une simple faculté, laissée à l’appréciation et à l’initiative de la police ? La privation d’eau et de nourriture d’un sans-papier, pourvu qu’elle soit adaptée aux besoins de l’enquête, ne constituerait qu’une gêne supportable – si ce n’est inévitable ?
Il est vrai que ni la Déclaration universelle des droits de l’homme, ni la Constitution française ne précisent que la République doit remettre à chaque prisonnier une cruche et un quignon de pain. Et d’ailleurs, pourquoi pas de la brioche, et cinq fruits et légumes par jour ?… Il faut aussi reconnaitre que sauter un repas avant d’être expulsé, c’est bien peu de choses pour un sans-papier. Puisqu’il s’apprête à repartir crever de faim dans son pays d’origine, autant qu’il s’y prépare tout de suite. Ainsi qu’on l’enseigne dans les facs de Droit : « ti bouffes, ti bouffes pas, ti crèves quand même ! »
 Cependant, quels que soient les mérites de l’argumentation développée par le premier président quant à la quotité acceptable de privations subie par un justiciable étranger lors de sa retenue, ils n’ont pas la moindre chance de venir troubler la digestion de la juridiction supérieure, qui a déjà dit le droit dans une décision rendue le 1er décembre 2010. La Cour de cassation y approuve sans réserve une juridiction qui avait libéré un sans-papier, simplement parce qu’entre son arrivée au tribunal à 9 heures et l’audience qui s’était tenue à 17 heures, il n’avait reçu ni nourriture ni boisson. Et la haute juridiction d’écarter toute possibilité d’accommodement avec la règle : il importe peu que l’étranger n’ait formulé aucune demande ni essuyé aucun refus ; il est totalement indifférent que cette contrainte n’ait duré que « pendant le temps strictement nécessaire ».
Cependant, quels que soient les mérites de l’argumentation développée par le premier président quant à la quotité acceptable de privations subie par un justiciable étranger lors de sa retenue, ils n’ont pas la moindre chance de venir troubler la digestion de la juridiction supérieure, qui a déjà dit le droit dans une décision rendue le 1er décembre 2010. La Cour de cassation y approuve sans réserve une juridiction qui avait libéré un sans-papier, simplement parce qu’entre son arrivée au tribunal à 9 heures et l’audience qui s’était tenue à 17 heures, il n’avait reçu ni nourriture ni boisson. Et la haute juridiction d’écarter toute possibilité d’accommodement avec la règle : il importe peu que l’étranger n’ait formulé aucune demande ni essuyé aucun refus ; il est totalement indifférent que cette contrainte n’ait duré que « pendant le temps strictement nécessaire ».
Pour un prisonnier, recevoir de la nourriture et de la boisson, c’est tout simplement une question de respect des droits les plus élémentaires de la personne. Ça ne devrait même pas être discuté.
Le matin du 25 juillet 2013, pendant que le premier président de la Cour d’appel délibérait, Monsieur D. comparaissait à une autre audience qui se tenait devant le tribunal administratif. Lorsqu’il est revenu vers midi au centre de rétention, le greffe lui a remis l’ordonnance du juge judiciaire, qui prolongeait sa rétention. Monsieur D. lui a tendu en retour l’ordonnance du juge administratif, qui venait au contraire de décider de le libérer.
Conséquence de l’annulation de l’arrêté préfectoral par cette dernière juridiction ? La décision du premier président, qui voulait prolonger une rétention elle-même illégale, était automatiquement annulée, pour perte de fondement juridique (Cass. Civ. 14 mars 2012).
Monsieur D. a soigneusement remisé la décision de la cour d’appel au fond de sa poche, récupéré ses affaires, et quitté le centre de rétention. C’était l’heure du déjeuner.
