 Durant le dernier quinquennat, les rarissimes avancées en matière de droit des étrangers ont été réalisées, non pas à l’initiative des ministères, du parlement ou des plus hautes juridictions françaises, mais bien des instances européennes, qui ont introduit un peu de droit dans un monde de brutes. Il y eut, notamment, les arrêts CJUE 22 juin 2010 Melki c. France (« bande des 20 kilomètres »), CEDH 14 octobre 2010 Brusco c. France (assistance de l’avocat en garde à vue), CEDS 28 juin 2011 Cohre c. France (discrimination à l’encontre des Roms), CJUE 6 décembre 2011 Achughbabian c. France (détention d’un clandestin avant son éloignement)…
Durant le dernier quinquennat, les rarissimes avancées en matière de droit des étrangers ont été réalisées, non pas à l’initiative des ministères, du parlement ou des plus hautes juridictions françaises, mais bien des instances européennes, qui ont introduit un peu de droit dans un monde de brutes. Il y eut, notamment, les arrêts CJUE 22 juin 2010 Melki c. France (« bande des 20 kilomètres »), CEDH 14 octobre 2010 Brusco c. France (assistance de l’avocat en garde à vue), CEDS 28 juin 2011 Cohre c. France (discrimination à l’encontre des Roms), CJUE 6 décembre 2011 Achughbabian c. France (détention d’un clandestin avant son éloignement)…
Le profane qui entreprend, avec courage et humilité, la lecture d’un arrêt rendu par les grandes chambres de ces juridictions européennes, éprouve la sensation d’entrer en religion, de s’approcher de ce qu’elle a de plus sacré, et voit parfois jaillir la lumière. Alors qu’en lisant les décisions rendues sur le même sujet par des juges locaux, on a parfois l’impression d’entrer dans une classe de catéchisme, à l’heure de la pause-goûter.
L’esprit gaulois est ainsi formé que les juridictions françaises inférieures peinent sérieusement à tenir compte des décisions prises par des juridictions internationales supérieures. A l’époque de l’arrêt Danayan c. Turquie, de nombreux juges, suivant en cela les consignes ministérielles, arrêtaient la lecture de l’arrêt dès la première ligne, s’écriant : « C’est marqué ‘Danayan contre Turquie‘. la France n’est donc en rien concernée ! » Lorsque l’arrêt Brusco contre France est tombé, les mêmes professaient qu’ils avaient enfin compris, mais qu’ils continueraient d’appliquer la loi française aussi longtemps que le législateur ne l’aurait pas changée. Il est vrai qu’en matière de droit des étrangers, si les jugements suscitent souvent l’étonnement, les bonnes surprises ne constituent pas le sentiment dominant.
Parmi les innombrables variantes apparues dans les prétoires, visant à écarter les textes et jurisprudences supranationales, l’une d’elle mérite qu’on s’y attarde, car la discussion est vieille comme mes robes.
Appelé le 24 janvier 2012 à statuer pour la première fois sur la question de la compatibilité de la garde à vue ‘ à la française ‘ avec la dernière jurisprudence de la CJUE (arrêt Achugbabian devant la cour de Luxembourg le 6 décembre 2011 : 13 juges, 42 jours de délibéré), un juge lillois rendait en 25 mn la décision suivante :
« Il est soutenu l’irrégularité de la garde à vue au regard des textes réglementaires, législatifs et des décisions judiciaires de la CJUE ; il est exact que depuis un certain temps, de nombreuses décisions nationales et européennes se sont chevauchées, contredites, neutralisées pour aboutir à une situation trouble où l’esprit du droit européen se heurte au droit national, laissant les magistrats nationaux oeuvrer dans des zones juridiques encore incertaines en l’attente d’une harmonisation espérée ; s’il faut admettre l’utilité de procéder aux mesures de reconduite avant de mettre en oeuvre les mesures coercitives de garde à vue ou d’emprisonnement, il faut aussi reconnaître la nécessité d’ordre public de conserver un minimum d’autorité et de coercition compatible avec la simple vérification d’identité et les vérifications aux différents fichiers en liaison avec les autorités étrangères ; que si l’esprit [du droit européen] est et doit rester le principe, la nécessité doit faire loi ; en conséquence, il faut bien admettre qu’une mesure de coercition même limitée doit rester possible pour mettre en oeuvre les mesures de reconduite à des étrangers, qu’écarter toute mesure de garde à vue même limitée conduirait chaque étranger interpellé à refuser de se soumettre à toute vérification, ce qui mettrait à néant toute politique de reconduite à la frontière ; il s’ensuit que la mesure de garde à vue appliquée à l’étranger était nécessaire à la mise en oeuvre des mesures administratives de reconduite à la frontière. »
Laissons aux auditeurs de l’ENA ou de l’ENM le soin de pérorer sur la dernière portion, qui ferait un excellent sujet de « Grand O’ » : « Identifiez dans la loi et les principes généraux du droit ce qui permet de prendre une mesure pénale (telle que la garde à vue) à des fins purement administratives (telle que la reconduite à la frontière). »
Attachons-nous plutôt à deux autres citations, qui ouvrent la voie à d’intéressantes évolutions jurisprudentielles.
La hiérarchie des normes, telle que revue et corrigée par la décision précitée, aurait pour principales qualités la cohérence et l’efficacité. De bas en haut : les actes administratifs ; les règlements ; les principes généraux du droit ; les lois ; les traités, accords et conventions internationaux ; la nécessité.
Afin d’éviter tout risque d’arbitraire (selon l’adage, « Dieu nous préserve de l’équité des parlements »), encore resterait-il à dégager un critère clair, net et précis, qui permettrait au juge de distinguer ce qui est « nécessaire » de ce qui, étant seulement « utile », ne l’est point.
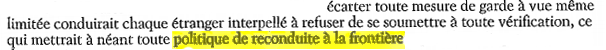
C’est le second apport de l’ordonnance citée. Au cas d’espèce, la garde à vue devait être validée parce qu’elle se situait au sommet de la nouvelle hiérarchie des normes juridiques. Et si elle était aussi incontestablement « nécessaire », c’est parce qu’elle s’abstenait de « mettre à néant la politique de reconduite à la frontière ».
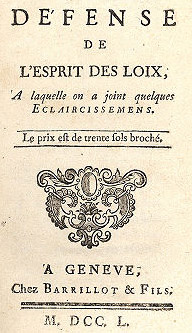 Certes, depuis des siècles, la doctrine est très réservée quant à la place qu’il convient d’accorder à la politique dans les prétoires. En 1664, le juge Olivier Le Fèvre d’Ormesson, lors du procès de Nicolas Fouquet, avait résisté aux injections du roi Louis XIV, avec ces mots : « La cour rend des arrêts, non des services ». Un siècle plus tard, dans L’esprit des lois, Montesquieu théorisait la séparation des pouvoirs. L’une de ses conclusions était la suivante : lorsque la politique entre dans un tribunal… la justice en sort à toute vitesse ; et si possible, en évitant de se casser la binette.
Certes, depuis des siècles, la doctrine est très réservée quant à la place qu’il convient d’accorder à la politique dans les prétoires. En 1664, le juge Olivier Le Fèvre d’Ormesson, lors du procès de Nicolas Fouquet, avait résisté aux injections du roi Louis XIV, avec ces mots : « La cour rend des arrêts, non des services ». Un siècle plus tard, dans L’esprit des lois, Montesquieu théorisait la séparation des pouvoirs. L’une de ses conclusions était la suivante : lorsque la politique entre dans un tribunal… la justice en sort à toute vitesse ; et si possible, en évitant de se casser la binette.
Mais foin de dogmatisme ! Plutôt que la politique, mieux vaut fuir l’aléa judiciaire, qui rend la justice incompréhensible pour l’opinion publique et imprévisible pour le justiciable, qui fait que le procès se perd dans les limbes de zones juridiques incertaines. Plutôt que de risquer « un gouvernement des juges », qui paralyserait à la fois la loi et l’ordre, mieux vaut « des juges de gouvernement » : au moins tout le monde est d’accord !
Il est donc préférable que les magistrats, plutôt que d’être seulement soumis à la loi, le soit in fine à l’impérieuse nécessité qu’il y a de mettre en oeuvre la politique gouvernementale – plutôt que la laisser en échec. Quid juris, certes (Que dit le droit ?) ; mais avant tout Quid politis (Que dit le politique ?)
L’équipe de Nicolas Sarkozy a été mal inspirée : depuis dix ans, elle n’a cessé de prendre de nouvelles lois, censées « harmoniser » (=atomiser) le droit de étrangers. L’équipe de François Hollande serait bienvenue de méditer cette solution : ne changez plus les lois ; dites simplement qu’elles ne sont plus nécessaires.
Quant aux avocats qui, à compter du 15 mai 2012, plaideront en faveur des sans-papiers, n’oubliez pas que si les Codes et la jurisprudence conservent leur utilité, un document les supplante tous : le programme du Parti Socialiste. A ce sujet, munissez-vous de préférence du « Programme commun de gouvernement » de 1971. Car contrairement aux Codes, les programmes politiques les plus récents ne sont pas toujours les plus modernes. Et pour départager les juges rétifs, une carte d’adhérent du P.S. fera l’affaire. Vous la brandirez en salle d’audience en criant : « Monsieur ! J’ai juridiquement raison, parce que je suis politiquement majoritaire ! »
