Pour cette quatrième édition du Prix Créon de la jurisprudence, le jury, après en avoir délibéré, a choisi de distinguer trois décisions (dont deux rendues le même jour par le même auteur), visant à restreindre la liberté d’une personne étrangère qui revendique des droits. Conformément au règlement, ces ordonnances ont été retenues pour leur capacité à susciter chez le lecteur une vive émotion : béatitude, fou-rire, incompréhension.
Catégorie béatitude
Juge des libertés et de la détention de Meaux, 7 février 2018
Tout commence le 5 février 2018 après-midi, lorsqu’une zélée fonctionnaire de la préfecture de police de Paris, très attachée aux objectifs chiffrés du ministre de l’Intérieur, et très détachée de la législation française et des conventions internationales qui s’y opposent (deux qualités qui valent généralement de l’avancement dans la préfectorale) décide de placer en rétention administrative Mme Awa S., une femme de 21 ans… et son bébé de 13 mois.
La jeune femme a pour unique défaut d’avoir demandé d’asile en France, alors que la préfecture préférerait qu’elle aille le faire en Italie. Quant à son bébé, il a pour principal défaut… Non, en fait, le préfet n’a rien trouvé à reprocher au bambin… En tout cas rien qui puisse justifier de l’enfermer derrière des barreaux aux côtés de sa mère. Alors l’administration feint d’ignorer complètement son existence : l’arrêté préfectoral, modèle d’inhumanité, n’évoque nulle part la présence de l’enfant et le sort funeste qui l’attend.
Placés au centre de rétention du Mesnil-Amelot, l’enfant et sa mère sont emmenés dès le lendemain matin à l’aéroport. Mme Awa S. refuse d’embarquer dans l’avion. L’affaire aurait pu s’arrêter là. Mais en matière d’infamie, l’administration sait être performante : elle renvoie la mère et son bébé au centre de rétention, et demande au juge des libertés et de la détention (J.L.D.) de Meaux de prolonger leur enfermement de 28 jours supplémentaires.
Les bons juristes, ou simplement les lecteurs attentifs de ce blog, se diront : « Le préfet va voir ce qu’il va voir ». Mais le préfet va voir tout autre chose…
D’ailleurs, le juge ne verra ni la mère ni l’enfant. Juste leur image. Car le magistrat n’ira pas à la rencontre des personnes retenues. Il préférera regarder la télévision. Cela s’appelle la « visio-conférence ». Et cela consiste à tenir l’audience « avec des moyens de télécommunication audiovisuelle » (L552-12). Avec ces ersatz de débats, les retenus sont non seulement repoussés du lieu où se rend la Justice, mais également tenus à l’écart de leur juge. Pour expliquer pourquoi il n’a pas jugé bon de se déplacer à « l’annexe » du centre de rétention, le premier juge invoque « des conditions climatiques exceptionnelles ». En effet, des flocons de neige sont tombés… ce qui n’empêche nullement l’aéroport de continuer à fonctionner… et donc le préfet de continuer à expulser.
Mme Awa S. ni son bébé n’ont rien à faire en rétention
Avant toute chose, il faut rappeler à ceux qui l’ignoreraient ou feindraient de l’ignorer : Mme Awa S. ni son bébé n’ont rien à faire en rétention.
D’abord parce qu’à la date du 5 février 2018, la loi française, qui n’a toujours pas défini les conditions dans lesquelles un étranger sous procédure Dublin peut être considéré comme présentant un « risque de fuite », n’autorise pas son placement en rétention (Cass. Civ. 1re 27 septembre 2017 ; Conseil d’Etat, 5 mars 2018).
L’argument est imparable. Il est… rejeté par le premier juge.
Rappelons que la Cour de cassation – laquelle a d’ailleurs rendu le même jour un arrêt qui rappelle la règle de Droit – est la plus haute juridiction judiciaire française. Elle est considérée comme une « cour régulatrice », et ses arrêts sont les seuls à pouvoir mériter le qualificatif de « jurisprudence ». Tout le reste – et l’ordonnance rendue par le juge de Meaux en fait partie – est considéré comme de simples « décisions ».
Lorsque des juridictions refusent d’appliquer la solution dégagée par les plus hautes juridictions françaises ou internationales, la doctrine déclare qu’elles « font de la résistance ». A noter que les avocats des préfectures, lorsqu’ils sont parvenus ces derniers mois à tromper la vigilance de quelques juges sur cette question de la rétention des « Dublinés », emploient cette expression à leur endroit – ravis qu’ils sont de leur avoir joué un bon tour.
Le verbe « résister », qui n’est pas dénué de grandeur, n’est cependant pas forcément le plus approprié. Pour des décisions qui, contra legem, font choix d’emprisonner pendant 28 jours une femme de 21 ans et son bébé de 13 mois, pour la plus grande joie d’un préfet douteux et le bon plaisir d’un ministre versatile, le terme « regimber » suffira.
Le juge des libertés et de la détention va donc écarter la jurisprudence de la Cour de cassation en recourant à un sophisme magistralo-préfectoral. Selon le premier juge, puisque Mme Awa S. n’a pas répondu à une convocation de l’administration le 14 novembre 2017 et qu’en conséquence, le préfet l’a déclarée « en fuite », il importe peu de savoir si elle présente ou non un « risque de fuite » : puisque, de facto, elle l’est déjà (« en fuite »).
L’erreur de raisonnement patato-juridique est patente. Car il confond, pour les besoins de la démonstration, deux choses différentes :
- La « fuite » de l’étranger (articles 5 et 29 du règlement Dublin), laquelle peut être déclarée uniquement pendant les six premiers mois de la procédure. La « fuite » est définie comme des manœuvres d’obstruction de l’étranger aux fins d’empêcher la détermination de l’Etat membre responsable ou son transfert vers celui-ci. La « fuite » a pour seul effet de prolonger de douze mois la possibilité de transfert vers l’Etat membre responsable.
- Le « risque de fuite » de l’étranger (articles 2 et 28 du règlement Dublin), qui peut être constaté tout au long de la procédure, laquelle peut durer jusqu’à dix-huit mois. Ce « risque de fuite » est apprécié par l’administration au moment où elle décide d’exécuter le transfert, et ne peut être fondé que sur des « critères objectifs définis par la loi » (étant rappelé que cette loi n’existait alors toujours pas en France). Le « risque de fuite » a pour seul effet de permettre le placement en rétention de l’étranger « jusqu’à l’exécution du transfert » (article 28 3° du même règlement).
Ce n’est pas parce qu’on est « en fuite » au sens de l’article 29 du règlement qu’on présente nécessairement un « risque de fuite » au sens de l’article 28. Parce ce risque de fuite s’apprécie in concreto, au moment de l’éloignement de la personne, et sur la base d’un texte de loi.
Les deux expressions sont distinctes ; les deux notions sont autonomes ; et il n’y a aucune automaticité de l’une sur l’autre. Erreur de vocabulaire, erreur de raisonnement, erreur de droit : cela commence à faire beaucoup.
Ce n’est pas tout.
« La police ne doit pas tirer sur les moineaux à coup de canon »
Lorsqu’il statue sur la légalité d’une décision préfectorale, le juge des libertés et de la détention devient, à l’instar du juge administratif, « le juge de l’administration ». Pour qu’il déclare légal l’arrêté du préfet, il doit s’assurer que celui-ci est suffisamment motivé. Autrement dit, l’acte administratif doit énoncer tous les éléments qui ont été pris en considération avant que la décision ne soit prise. Ceci permet au juge de s’assurer que l’administration a suffisamment examiné la situation de la personne, ce qui l’a mise en mesure de prendre une décision équilibrée.
Or, nous avons vu que le préfet de police s’était soucié comme de sa première bavure des conséquences que pourrait entraîner, pour le bébé, sa décision d’enfermer sa mère : l’arrêté n’en parlait même pas (Flûte… On a oublié le gosse !)
Concernant la motivation, le premier juge est catégorique : « le préfet n’est tenu de retenir, dans sa motivation, que les éléments positifs servant de fondement à sa décision ». Contrôler que tous les « éléments positifs » (favorables aux mesures restrictives de liberté) aient bien été pris en compte ; ne pas vérifier que le moindre « élément négatif » (favorable à la liberté de la personne) l’ait été. L’examen de proportionnalité, c’est quoi ça ? Ouh là, là, trop compliqué : mieux vaut laisser cela de côté !
Cependant, si certains d’entre vous – même des juges judiciaires – s’intéressent à la question, ils pourront utilement se rapporter à ce qu’en écrivait Jean-Marc Sauwé, dans « le principe de proportionnalité, protecteur des libertés ». Son exposé commence par une citation d’un juriste allemand : « La police ne doit pas tirer sur les moineaux à coup de canon » ; il se poursuit en rappelant l’office du juge français, lorsqu’il vérifie (vraiment) qu’une mesure restrictive de liberté est mesurée et nécessaire.
L’absence d’examen approfondi de la situation de la mère et son enfant (révélé notamment par le défaut de motivation de l’acte) sera pareillement jugé sans conséquence par le J.L.D. de Meaux : « la circonstance que l’arrêté querellé ne mentionne pas que la retenue est mère d’un jeune enfant ne permet pas de déduire que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle. » Ainsi donc, si un fonctionnaire ne dit rien de la situation d’une personne, c’est bien la preuve qu’il l’a parfaitement examinée. Notez, Monsieur le greffier : il est parfaitement loisible de continuer à approuver bruyamment tout ce que dit le préfet, même lorsqu’il se tait.
Voilà quelques années, dans une décision remarquée, une juge des libertés et de la détention avait considéré que le placement en rétention d’une famille avec enfants constituait « un traitement inhumain et dégradant », peu important que « le centre de rétention dispose d’un espace réservé à l’accueil des familles ». La magistrate s’était référée à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (C.E.S.D.H.) et à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (C.I.D.E.) A la suite de cette décision cinglante, le tribunal administratif avait condamné le préfet qui avait pris cette décision inhumaine à verser 4.000 € de dommages-intérêts à la famille.
Autre temps, autre juge. Le 7 février 2018, pour le magistrat de Meaux, il suffit de savoir que « le centre de rétention du Mesnil Amelot permet d’accueillir des enfants mineurs » et de constater que « la retenue n’est pas séparée de son enfant », pour écarter les accusations de violation de l’article 3 de la CESDH (traitement inhumain et dégradants) et de l’article 8 de la même Convention (vie privée et familiale).
Le jugement rendu par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 7 février 2018 a bien mérité le Prix Créon 2018 (catégorie béatitude, en raison de ses nombreux considérants).
Catégorie fou-rire
Cour d’appel de Paris, 9 février 2018
Mme Awa S. forme évidemment un recours contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux. La décision d’appel est rendue le 9 février 2018 par le magistrat désigné par le premier président de la Cour d’appel de Paris.
Certes, la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a beaucoup inspiré le Jury du Prix Créon. Mais celle de l’ordonnance du délégué du premier président la supplante largement.
Pourtant, à première lecture, ce n’était pas gagné. En effet, la Cour d’appel – comme cela arrive de plus en plus fréquemment – a d’abord procédé par « adoption de motifs ».
Ce procédé consiste, pour le juge du second degré, à confirmer la décision dont appel, en se référant simplement, pour l’approuver sans réserve, à l’examen et aux développements opérés par le premier juge.
Cela donne ceci : « La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire ».
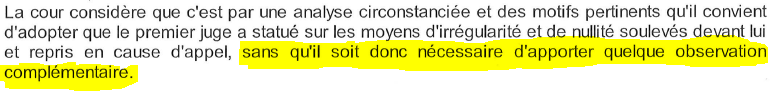
- Ah ! Qu’en termes galants ces choses-là sont mises. (Molière)
- Allons ! embrassons-nous, Folleville ! (Labiche)
Disons-le, ce n’est plus du Droit : c’est de la littérature !
Poursuivons donc notre parenthèse culturelle, pour nous pencher sur les origines de cette manie qu’ont certains juges d’appel de se contenter de dire que tout a déjà été fort bien jugé. Des historiens du Droit font remonter cette expression et cette pratique (« adopter les motifs ») à Dagobert 1er, qui l’aurait transmis à partir de l’an 631 à ses successeurs, lesquels sont connus en France sous l’appellation de « rois fainéants ». Le chroniqueur Erchambert écrivait de ces rois – qui ne régnaient sur rien : « Ces rois ne régnaient que de nom ; c’était leur usage de ne rien faire ou résoudre, de saluer et d’être salué ». Le procédé aurait donné d’ailleurs lieu à une comptine célèbre – quoiqu’apocryphe : « Le bon roi Dagobert a pris un jugement à l’envers. » Fin de la parenthèse culturelle.
Donc, puisque la décision rendue à Meaux a gagné un Prix Créon, et que celle rendue à Paris a procédé par « adoption de motifs » : par conséquent, l’ordonnance rendue par la juridiction du Premier président de la Cour d’appel de Paris le 9 février 2018 a bien mérité un Prix Créon (catégorie fou-rire, à cause du roi Dagobert).
Catégorie incompréhension
Cour d’appel de Paris, 9 février 2018
Et nous en arrivons au troisième prix, qui se trouve être… une variante de l’ordonnance précédente.
Car la vérité oblige à reconnaître que le deuxième Prix Créon ne constitue pas, stricto-sensu, une décision, mais plus exactement un « projet de décision ». Cependant, dès lors qu’il a été publié – même à l’état d’ébauche – il pouvait légitimement concourir.
L’histoire de cette ordonnance est passablement compliquée, et a pu être établie grâce aux échanges entre la Cimade, le Gisti, et la première présidente de la Cour d’appel de Paris. L’affaire a fait beaucoup parler d’elle sur Twitter, sur Médiapart et dans Le Canard Enchaîné, et il faut en retenir ceci.
Au cours de son délibéré, le juge parisien a préparé un « premier jet » de sa décision, dont l’attendu unique est cité in extenso plus haut. Comme on l’a vu, cette version se contentait de reprendre la totalité des erreurs commises par le premier juge – ce qui n’est déjà pas mal.
Mais après ce qui s’apparente à un simple copier-coller – accompagné d’un hommage appuyé à l’excellence du raisonnement de son collègue de Meaux – le juge d’appel de Paris s’est ravisé, et a décidé d’y ajouter un trait de sa meilleure plume. La version « brouillon » a, par erreur, été transmise et publiée sur les bases de données juridiques ; tandis que la version définitive était remise, à l’audience, à l’étrangère et au préfet. A la lecture de celle-ci, plutôt que de celle-là, le Jury du Prix Créon s’est exclamé :
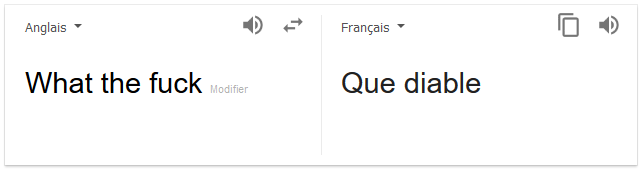
Les âmes sensibles vous devoir en convenir : entre ces deux publications, le texte martyr a beaucoup souffert. Car sur la version définitive, à la place du dernier groupe de mots (« il n’est pas nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire »), figure maintenant cet ajout considérable : « l’application des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne relève pas, en tout état de cause, de la compétence du juge judiciaire. ».
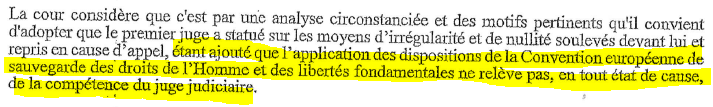
Voilà donc l’intime conviction, la réflexion profonde, la quintessence de la pensée de ce juge. Après avoir pris le temps de la réflexion, après avoir soupesé chaque mot de son projet d’ordonnance, ce haut magistrat a transformé ce qui n’était que de la belle ouvrage en un véritable chef d’œuvre. C’est dit, c’est écrit, c’est publié : lorsqu’il rend des décisions au nom du Peuple français, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris ne tient aucun compte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Laquelle C.E.S.D.H. comprend notamment, ainsi que le rappellent très régulièrement les jurisprudences de la Cour de cassation : l’interdiction des traitements inhumains, l’accès à un tribunal impartial, les droits de la défense et le principe du contradictoire, le procès équitable, le respect de la vie privée, la liberté d’expression…
La seconde ordonnance rendue par la juridiction du Premier président de la Cour d’appel de Paris le 9 février 2018 a bien mérité le Prix Créon 2018 (catégorie incompréhension, parce que bon, la CESDH, quand même…)
Whiskey Tango Foxtrot
Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que la juridiction du premier président de la Cour d’appel de Paris suscite l’attention.
Le 21 février 2017, le même magistrat avait infirmé une meilleure ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny, et ordonné le maintien en zone d’attente d’un enfant syrien âgé de deux ans et demi. Déjà à l’époque, il soutenait que « l’application de [la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ». Et pour faire bonne mesure, il avait ajouté qu’à son avis, le maintien en zone d’attente d’un bébé était… « nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays et à la défense de l’ordre » (W.T.F. ?)
Hé non ! cette ordonnance du 21 février 2017 n’était même pas un gag. Quel dommage qu’elle n’ait pas concouru pour le Prix Créon 2017.
Le Jury du Prix Créon félicite les lauréats 2018, et espère les revoir l’année prochaine.
Prix Créon de la jurisprudence 2019-2020
Faute de candidats, par décision spéciale du Jury, l’attribution du prix Créon de la jurisprudence, qui devait intervenir le 1er avril 2019, a été reporté au 1er avril 2020.
Pour cette cinquième édition du prix Créon de la jurisprudence, il est rappelé les CONDITIONS A REMPLIR pour concourir :
- La décision a été rendue par une juridiction française : JLD, Premier président, Cour de cassation, Tribunal administratif, Cour administrative d’appel, Conseil d’Etat, Tribunal de Grande Instance, Cour nationale du droit d’asile…
- Elle concerne le droit des étrangers : séjour, rétention, nationalité…
- Elle a été rendue entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2020.
- Elle est adressée au webmaster de ce site internet : contact[at]pole-juridique.fr.
- Elle est obligatoirement accompagnée d’un commentaire rédigé par l’expéditeur, et si nécessaire, de tous les documents nécessaires à sa compréhension (documents anonymisés).

