« Il n’y a que la méthode qui a changé. » Le reportage que France 2 a consacré le 2 juillet 2014 à l’expulsion des réfugiés de Calais s’ouvre sur un constat qui pose question : « Ce matin, l’évacuation des migrants s’est faite à l’abri des regards, loin des caméras des journalistes et des militants associatifs ». Mais que cherchaient à cacher les pouvoirs publics ? En quelques heures, on comptait 540 contrôles d’identité, suivis de 204 placements en centres administratifs. Mais deux jours plus tard, la préfecture annonçait qu’elle ne demanderait pas aux juges des libertés et de la détention de prolonger les rétentions. Pas de saisine des juges judiciaires dans les cinq jours (L552-1 CESEDA), donc pas de transmission des dossiers, donc aucun contrôle par des autorités indépendantes quant aux conditions d’interpellation de plusieurs centaines de personnes. Mais que cherchaient-ils à cacher ?
L’expulsion du « camp Salam » de Calais, le 2 juillet 2014 (évacuation des militants à partir de 4:15) © IndymediaBxl
En langage de politicien, la fin justifie les moyens : examinons la finalité de l’expulsion.
Il fallait tout d’abord vider le lieu de distribution des repas, suite à la plainte déposée le 25 juin 2014 par la maire de Calais. Il fallait ensuite remplir les centres de rétention de Lille, Rouen, Metz, Rennes, et de la région parisienne, que le gouvernement avait préalablement vidés pour faire de la place.
Mais en langage de juriste, la fin ne justifie rien du tout : examinons la procédure.
Depuis le 28 mai 2014, date du démantèlement des camps de migrants installés quai de la Gironde, plusieurs centaines d’entre eux avaient trouvé refuge au lieu-dit « terre-plein Darquer », un espace grillagé ouvert par deux portails rue Lamy. La ville de Calais y gère les installations de distribution des repas aux sans-papiers. S’agissant d’un lieu d’accès restreint, non ouvert à la circulation, les policiers et gendarmes ne pouvaient y pénétrer librement. Il leur fallait détenir l’autorisation de l’occupant légitime, obtenir une décision de justice, ou établir un flagrant délit.
Ces trois circonstances étaient réunies. La maire ne demandait pas mieux que de laisser rentrer les forces de l’ordre, puisqu’elle avait expressément demandé « l’évacuation de cette zone ». Les forces de l’ordre disposaient également d’une ordonnance d’expulsion, rendue cinq jours plus tôt par le tribunal administratif. Enfin, l’enquête de flagrance, pour le délit d’« installation en réunion sur un terrain et sans autorisation » (art. 322-4-1 CP) avait été ouverte il y a moins de huit jours (art. 53 2° CPP). C’était bien parti.
Ce n’était plus un simple « ouvre-boîte » vers le terre-plein Darquer, mais un véritable couteau suisse. Il fut décidé de privilégier la bonne vieille lame appelée « enquête de flagrance » (bien qu’elle soit grosse, un peu rouillée et très tordue).
C’est donc parce que « des personnes » (c’est le seul mot employé dans la plainte) avaient planté leurs tentes en dehors d’un camping municipal qu’au crépuscule du 2 juillet 2014, des centaines de gendarmes et policiers sont entrés en force sur le terre-plein Darquer, afin – selon la version officielle – de mettre un terme à l’infraction prévue et réprimée par l’article 322-4-1 du Code pénal, et d’en identifier les auteurs.
Jusque-là, tout allait bien.
Et juste après, c’est devenu n’importe quoi…
A l’arrivée des forces de l’ordre, les tentes et les auvents se sont vidés de leurs occupants. Les migrants, ainsi que les journalistes et militants associatifs, ont été encerclés et repoussés au centre du terre-plein Darquer. Il ne restait plus aux enquêteurs qu’à constater la présence sur le site de plusieurs centaines de « personnes », à proximité immédiate des installations de toile, ce qui constituait une raison plausible de soupçonner qu’elles avaient commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elles étaient susceptibles de fournir des renseignements utiles à l’enquête (art. 78-2 2° et 4°CPP). Les agents et officiers de police judiciaire pourraient alors inviter toutes ces personnes à justifier, par tout moyen, de leur identité (78-2 1° CPP). A cette occasion, les forces de l’ordre découvriraient incidemment que certains, qui se déclaraient de nationalité étrangère, n’étaient pas en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels ils étaient autorisés à circuler ou à séjourner en France. Les gendarmes et policiers auraient donc le droit de les conduire dans un local et de les y retenir aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour sur le territoire français (L611-1 CESEDA).
Et le tour aurait été joué.
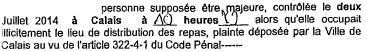
Mais ce qui s’est passé ce matin-là sur le terre-plein Darquer est légèrement différent. Tous les soutiens aux migrants, ainsi que les journalistes, ont été évacués. Les policiers ne leur ont pas ordonné par porte-voix de s’éloigner ; ils sont venus les « extraire » un par un, afin de les emmener à bout de bras très loin à l’écart du camp. Les migrants sont tous restés bloqués sur le lieu de distribution des repas. Les contrôles d’identité ont alors commencé.
Pa-ta-tra !…
Qu’est-ce qui permet à un agent ou un officier de police judiciaire assermenté de faire le tri entre les occupants illicites d’un terrain et les militants associatifs venus les soutenir ? Objectivement, rien. Laissons de côté le cas particulier des journalistes : certains portaient des brassards « Presse » ou du matériel estampillé. Mais sur les photos et vidéos prises lors de l’arrivée des forces de l’ordre, aucun signe distinctif n’est repérable chez les militants. Certains membres d’associations brandissaient des appareils, mais pas tous ; et de nombreux réfugiés étaient également munis de téléphones. Coude à coude, Français et étrangers avaient tenté de faire barrage à l’entrée des gendarmes et policiers. Quelques migrants portaient des sacs avec leurs affaires ; même chose pour les militants. Et côté vestimentaire, pas d’indice apparent de la commission d’une infraction : aucun des campeurs n’a été vu sortir de sa tente avec une robe de chambre, un pyjama, des pantoufles ou des babouches…
Reste un seul dénominateur, commun à tous ceux qui été expulsés du terrain sans être contrôlés.
Par un arrêt prétorien pris il y a trente ans (Crim. 25 avril 1985 du 25 avril 1985), la Cour de cassation a posé la règle suivant laquelle les gendarmes et policiers ne pouvaient, pour discriminer entre Français et étrangers, se référer qu’à « des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé ». La couleur de la peau n’en fait pas partie. Pas d’avantage que le fait de s’exprimer en langue étrangère (Civ. 14 décembre 2000).
Pour faire illusion, il suffisait aux policiers et aux gendarmes de contrôler l’identité de toutes les personnes présentes. Mais « l’enquête » a été menée ainsi : « Les Blancs, de ce côté-ci. Les Noirs et les Arabes, de ce côté-là : contrôle des papiers. »
Dans ses « 60 engagements pour la France », la 30e promesse de François Hollande était : « Je lutterai contre le « délit de faciès » dans les contrôles d’identité par une procédure respectueuse des citoyens ». C’est parce que, durant les périodes les plus sombres de l’Histoire de France, les rafles étaient rentrées dans les traditions nationales, qu’elles en ont ensuite été bannies. Sous la gouvernance de Manuel Valls, le temps se couvre.
